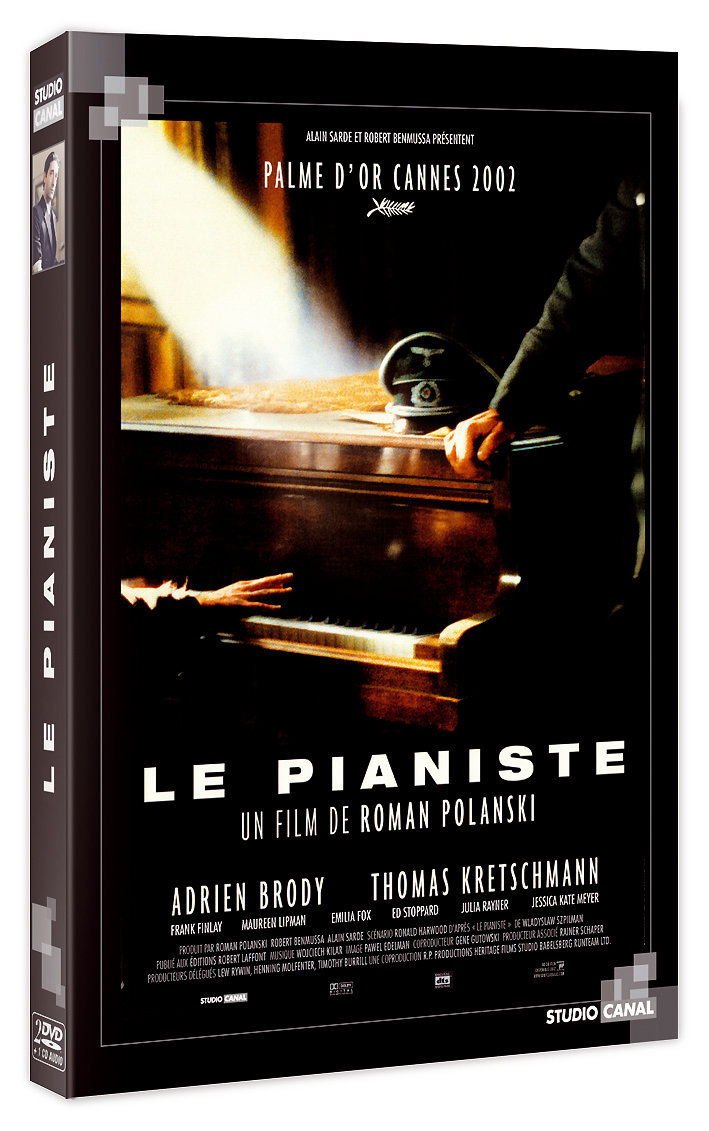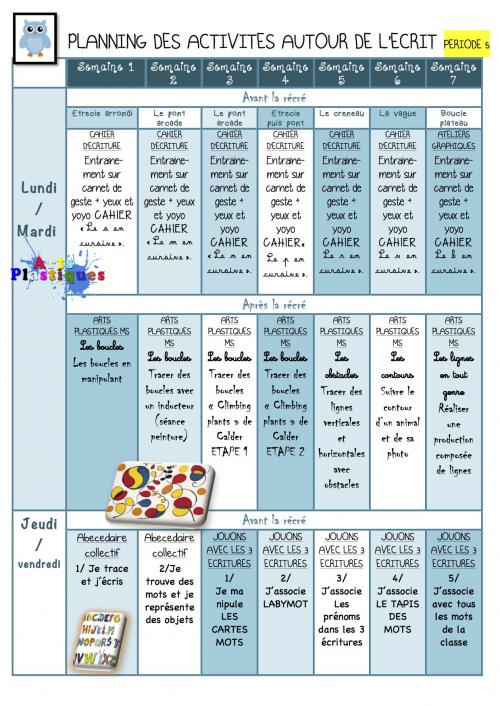J’ai longtemps hésité : Hermann Kopf est-il fou ou génial ? Il n’y a pas de génie sans folie ; j’ai parfois résolu le problème par ce cliché confortable. Mais maintenant, je sais : Kopf est un assassin. Et je n’y peux plus rien, depuis que j’ai découvert sa lettre dans ce lointain hôtel où il avait pris soin de m’envoyer. Ce n’était même pas la peine de me précipiter dans un taxi pour attraper le premier avion qui me ramènerait ici : il avait tout prévu, pris toutes les précautions. Je ne reverrai jamais Fiona, ses yeux gris qui fuyaient l’amitié et la tendresse que mes silences lui suppliaient d’accepter.
Hermann Kopf est fou. C’est ce que j’ai pensé en rencontrant cet étrange personnage, il y a de cela près de trois ans. Fou à lier – lier de ces bandelettes dont on se servait pour ces momies qu’il aimait tant, qui ont alimenté sa folie et qui l’ont mené dans cette prison où j’ai eu le malheur de faire sa connaissance. Malheur… je ne pensais pas cela à l’époque, au contraire. Pour être franc, j’ai pris Kopf pour la providence.
Je croupissais dans cette maison d’arrêt depuis quelques mois pour avoir été impliqué dans un scandale politico-financier. J’avais obéi à un ministre, puis j’avais servi de fusible comme il est de coutume. Mais les temps avaient changé : soit les fusibles n’étaient plus ce qu’ils avaient été, soit le courant de la justice était plus puissant. Toujours est-il que mon ministre avait perdu son poste et tout espoir de le récupérer, du moins pour quelques années. Quant à moi, les perspectives d’emploi après ma sortie, prévue pour dans une dizaine de mois en tenant compte de remise de peine pour bonne conduite, ces perspectives étaient pour le moins réduites, à moins de plonger sans plus tergiverser dans le monde de la franche criminalité qui m’avait déjà fait savoir qu’il saurait apprécier et utiliser les talents dont j’avais fait preuve au nom supposé du service public.
Kopf fut amené dans ma cellule un lundi matin. D’entrée, je fus intimidé par sa prestance et sa force ; sous son costume réglementaire, on devinait les étoffes précieuses que ce corps de géant devait avoir l’habitude de porter. Il mesurait au moins deux mètres et devait peser plus de 150 kilos, sans qu’on eût envie de le dire gros. Une fois que le gardien eût refermé la porte, nous nous retrouvâmes seuls, Kopf et moi ; moins d’un mètre nous séparait, que comblait mon embarras. Kopf ne semblait pas partager cette gêne. Sans dire un mot, il scruta les moindres recoins de la cellule, de ma personne. Puis, sa voix retentit, terrifiante et sépulcrale :
— Je m’appelle Hermann Kopf. Bien que je ne sois pas là pour longtemps, il me plairait de connaître votre nom et votre histoire. Comme disait l’autre, il se pourrait que je cherche un homme et que le destin m’indique que je le trouverai ici ; et comme j’ai souvent constaté que le destin n’est que rarement imaginatif, pourquoi ne s’agirait-il pas du premier venu, donc de vous ?
La fréquentation des cénacles politiques m’avait appris à être plus arrogant qu’à mon tour et la prison n’avait pas contrecarré cette tendance. Mais je ne réagis pas et j’entrepris de lui narrer par le menu toute mon histoire, d’une voix nouée et soumise qui ne s’assouplit pas comme le temps, lui avouant certains détails que même mes avocats ignoraient. Il m’écouta sans broncher, assis sur son lit, me fixant de ses yeux bruns qu’assombrissaient encore des replis de chair. Quand j’eus achevé mon récit, il resta silencieux, imperturbable, une main glissant sur un menton étonnamment glabre. Puis, il cligna des paupières et dit : « Bien, bien », avant de s’allonger sur le lit :
— À présent, je vous prie de m’excuser. Je suis fatigué et j’aimerais dormir un peu.
Je n’osai pas lui demander s’il se pouvait que je sois l’homme qu’il cherchait, et j’ignorais d’ailleurs si une telle perspective me conviendrait. Je le laissai dormir. Et nous n’échangeâmes plus une parole durant les dix jours où il partagea ma cellule avant d’en ressortir libre, comme il me l’avait annoncé. Cette période fut la plus pénible de mon incarcération ; le silence écrasant et le maintien hiératique de cet homme donnaient à notre cellule des airs de couloir de la mort.
Son départ fut un soulagement ; mais je ressentis aussitôt une frustration d’autant plus forte que je ne parvins pas à en identifier la cause précise.
Il me laissa le souvenir trouble d’un être bizarre, dérangé. Dérangeant. J’essayai de questionner les gardiens, mais personne ne semblait savoir pourquoi Kopf était passé entre ces murs ; à tel point que je fus un moment tenté de croire qu’il n’était venu que parce qu’il était, comme il me l’avait dit, à la recherche de quelqu’un – et il était reparti bredouille. Un fou.
Les dix mois restant de ma détention passèrent dans l’ennui, dans cette monotone torpeur qui est sans doute le châtiment le plus cruel que l’homme dit civilisé ose infliger à ses pareils, coupables de ne s’être pas conformés aux règles du jeu. Je n’avais rien fait durant cette peine : quelques lectures qui ne me laissaient aucun souvenir, quelques réflexions incohérentes aussitôt oubliées. Seule demeurait, profondément incrustée en moi, l’empreinte du passage fugace et mystérieux de Kopf, de ce géant énigmatique qui m’avait arraché les confidences les plus secrètes sans rien dévoiler de lui, sinon son imposante présence.
Je ne savais pas ce que je ferais à ma sortie. Je n’étais pas marié, je n’avais plus de famille depuis la mort de mes parents et plus d’amis depuis mon décès politique. Personne ne m’attendrait, sinon peut-être quelque journaliste en mal de copie – mais c’était m’attribuer trop d’importance que d’imaginer nourrir encore ne serait-ce qu’un entrefilet dans une gazette provinciale. À la veille de ma libération, j’avais bien en poche quelques adresses peu recommandables où l’on m’avait chaudement recommandé, mais je ne m’étais pas encore résolu à m’engouffrer dans cette voie sans issue ni retour.
Le gardien qui m’accompagna vers cette liberté dont je ne savais pas encore quoi faire, et avec lequel j’avais noué les meilleurs relations possibles étant donné l’endroit et nos statuts respectifs et plus ou moins respectables, me dit, en commandant l’ouverture de la lourde porte d’entrée :
— Je crois qu’il y a quelqu’un qui vous attend. Bonne chance.
Et de fait, il était là, campé sur le trottoir d’en face, sa masse énorme coulée dans un long manteau de cachemire bleu nuit au col d’astrakan. Il ne fit pas un geste à mon adresse, lorsque je sortis, mais le clignement de ses petits yeux me fit comprendre que c’était bien moi qu’il attendait et que, d’une certaine manière, cela faisait dix mois qu’il faisait ainsi le guet devant la maison d’arrêt.
Hermann Kopf est génial. Tel fut le second jugement que je portai sur cet homme providentiel, le soir même de ma libération, lorsque je me retrouvai dans la suite qu’il m’avait fait préparer dans son hôtel de maître du centre ville, où son chauffeur nous avait conduits. Dans la limousine, il avait conservé son allure mystérieuse et n’avait proféré que quelques phrases :
— Je suis heureux de voir que votre bonne conduite, comme je l’avais deviné, a abrégé votre séjour et accéléré le moment de nos retrouvailles. Je vous l’avais dit : je cherchais un homme et j’ai décidé que ce serait vous. Ne faites pas mine d’hésiter, je me suis renseigné : vous n’aurez aucune autre perspective d’emploi, à moins de recourir aux quelques contacts peu reluisants que vous avez été amené à nouer en prison. Vous méritez mieux. Ce que je vous propose est parfaitement honnête et conforme à vos talents. Je vous expliquerai.
Je m’étais laissé embarquer sans hésiter, trouvant normal qu’il m’attendît, qu’il m’offrît un voyage que j’acceptai sans savoir de quoi il en retournait. Ces dix mois d’attente m’avaient préparé à me soumettre à son charme glacé, au magnétisme redoutable et envoûtant de cette masse qui n’était avare que de ses gestes et de ses mots.
Son hôtel particulier, que j’eus le loisir de visiter en détails les jours suivants, était un incroyable musée rempli d’objets de valeur : toiles de grands maîtres dans chaque pièce, quelques sculptures – des Degas, des Rodin… –, des céramiques ; mais surtout, un nombre impressionnant d’antiquités grecques, égyptiennes et romaines. Le plus surprenant toutefois étaient des socles et des niches vides, qui avaient dû abriter, jusqu’à une période pas si lointaine, des pièces d’assez grande taille – dont je n’imaginais rien.
— Vous vous demandez ce qu’il y avait en ces endroits, n’est-ce pas ?
Il m’avait rejoint lors d’une de mes visites, sans que je l’aie entendu venir.
— Des objets d’assez grande taille, à en juger par le vide qu’ils laissent, répondis-je sans laisser voir qu’il m’avait effrayé.
Il eut cependant un fin sourire qui fit chanceler cette maigre assurance que j’essayais difficilement de récupérer depuis mon arrivée ici, et qui avait établi mes succès, du temps où j’excellais dans le monde politique.
— Vous m’amusez, mon cher. Par chance, les renseignements que j’ai pris sur votre compte me permettent d’espérer davantage que cette misérable déduction. Misérable, pas même élémentaire. Venez, il est temps sans doute que je vous explique les raisons de mon bref passage dans votre cellule ; ensuite, je vous ferai connaître ce que j’attends de vous. J’espère que vous ne me décevrez plus.
Et je le suivis dans son bureau, plus humilié qu’à l’heure de ma condamnation, devant le tribunal et la presse au grand complet.
Hermann Kopf était un homme immensément riche, grâce à quelques héritages providentiels et une parfaite gestion de son patrimoine, accomplie dans la plus complète transparence et légalité – comme j’ai eu, depuis, le loisir de le découvrir. Cela tenait aussi au respect qu’il marquait pour l’argent, ne dépensant jamais de manière excessive (tout est relatif) ou excentrique. Respect ou indifférence ? Avec le recul, et malgré les discours qu’il tenait à ce propos – si tant est que l’on puisse qualifier de discours les brefs monologues qu’il me dispensait à l’occasion –, je pense qu’il s’agit plutôt d’indifférence : il avait de longue date compris que l’argent ne serait qu’un outil dans sa quête, dans le dévoilement de l’unique secret qui lui semblât digne d’intérêt : l’au-delà.
— Le moment de la mort m’effraie parfois, quand j’y songe, mais il ne m’intéresse aucunement : c’est ce qu’il y a après qui me passionne. Non, je n’ai aucune crainte : mon esprit ne peut concevoir le néant. Je n’ai pas besoin d’avoir lu les philosophes ou les théologiens pour en avoir la certitude. D’ailleurs, j’avoue sans honte aucune que, sur cette question et celles qui gravitent alentour, je n’ai jamais rien lu. Rien. Pas une ligne. Pas même l’écoute bâillante d’une docte conférence. Je tiens toutes ces idées, tous ces raisonnements, ces théories pour moins qu’un vent coulis entre des tombes, dès l’instant qu’elles n’ont rien prouvé. Vous me direz : comment puis-je savoir qu’elles n’ont rien démontré si je n’ai rien lu ? Mais, mon cher, si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire de les lire pour profiter de vérités si cruciales qu’elles ne pourraient demeurer dans le cadre étroit d’un livre.
« Si je n’ai rien lu, j’ai observé ; là, je n’ai pas chômé. Tous les gestes, les actes posés par l’homme pour préparer l’au-delà ; je dis bien « préparer », non se le figurer. L’Occident chrétien, dans sa croyance officielle, m’apparaît du plus total désintérêt : on n’y prépare pas l’au-delà, on se contente d’assurer à ceux qui survivent la meilleure conscience possible pour retourner à leurs affaires : le mort peut pourrir, être brûlé, peu importe, du moment que ses héritiers continuent à profiter de la vie ! Cela, je ne l’ai pas appris en lisant, mon cher, mais en visitant un nombre incalculable de cimetières, partout en Europe, en Amérique du Nord, et même du Sud. Au mort de s’effacer pour laisser le champ libre aux vivants ; mais n’est-ce pas privilégier l’accessoire au détriment de l’essentiel ? Tandis qu’avant le christianisme…
C’est ainsi que j’ai appris ce qui avait occupé les espaces vides à présent : après la guerre, Hermann Kopf avait constitué, dans le plus grand secret, la plus impressionnante collection de momies qui soit, de toutes provenances. C’était le seul acte illégal qu’il ait jamais commis, à cette date ; en effet, depuis quelques décennies, les momies étaient assimilées par la loi au cadavre et, de surcroît, les pays d’origine en avaient interdit ou strictement réglementé l’exportation. Découvert ou dénoncé, Hermann Kopf avait fait un bref séjour en prison, avait dû restituer toutes les pièces aux États concernés et avait écopé d’une sérieuse amende ; mais seule la perte de ses momies l’affectait.
— Vous vous rendez compte ? Des cadavres, mes momies ! Quand je vous disais que seuls les actes posés en regard de l’éternité m’intéressent : que penser d’une civilisation qui considère des momies comme de vulgaires dépouilles ? Elle ne fait d’ailleurs que passer d’une hypocrisie à l’autre : au siècle passé, les Anglais les réduisaient par milliers en engrais et en combustible pour leurs locomotives ! Les actes, mon cher, on ne juge qu’aux actes…
Fou et génial, à la fois… à ce moment de son explication, il me ramena dans le salon pour revoir quelques pièces de sa collection sous ce curieux éclairage :
— Regardez ce Giacometti… autoportrait de l’artiste en être de l’infini… Épuré par la mort, prêt à affronter sans faim ni soif les confins de l’éternité ! Regardez mieux ces silhouettes du Greco, ou celles de Picasso : effrayantes esquisses ! À redouter le trépas, et surtout ce qui s’ensuit ! Mais admirez l’irréelle clarté d’un Manet, d’un Renoir, d’un Degas : là, tout n’est que beauté, luxe, calme… Et peu me chaut de savoir ce que d’illustres imbéciles ont pu produire comme gloses sur ces gestes bruts, instinctifs, sur ces cris d’animal qui essaie de se façonner un au-delà acceptable, viable ! Mais pas une de ces œuvres ne vaut une momie…
Jamais, depuis ce jour, Kopf ne m’a parlé si longtemps. Il conservait son calme glacé, même dans ses envolées. Ce qui me surprend le plus, aujourd’hui, c’est que je ne marquai pas le moindre étonnement, pas la plus petite inquiétude devant ces divagations ; je l’écoutais, séduit, envoûté, prêt à le suivre dans cet effroyable renversement qu’il n’exprima jamais clairement avant de l’opérer, et qui était l’ignoble clé de voûte de son imagination malade… Génial et fou, Hermann Kopf, qui avait dépensé des sommes considérables pour faire acheminer, dans le plus grand secret, de momies égyptiennes, incas, aztèques, qui avait passé des années, plongé dans cette confrontation absurde avec les « gestes », comme il les appelait. Et ce refus de savoir… l’homme qui avait, sans doute, détenu la plus vaste et la plus riche collection du genre n’avait rien lu qui eût pu l’enseigner sur la mentalité, les coutumes, les croyances qui avaient animé ces momies du temps de leur mouvance.
— Pour quoi faire ? Qu’est-ce que ces savants ont compris ? Que peuvent-ils m’apprendre de plus que le face à face avec ceux dont je me sens tellement proche ? Ils ont voulu se conserver intacts pour l’au-delà ! Admirable, non ? Voilà qui est prendre sa mort au sérieux ! Et ils ne partaient pas les mains vides, quand bien même elles étaient liées ! Certains allèrent jusqu’à refuser de partir seul, exigeant la mise à mort de toute leur suite, épouse en tête ! Merveilleux ! Mais aussi, quel triste résultat… À quoi ressemblent encore ces corps rabougris, desséchés ? Vidés de leurs viscères, ou le tout tellement déshydraté… Après quelques générations, n’ont-ils jamais osé voir ce que ça donnait ? Considéraient-ils si peu leur cerveau, leur foie, leurs intestins qu’ils pensaient pouvoir s’en passer pour l’éternité ? Regrettaient-ils, au fond, de n’avoir pas les moyens de mieux faire ? Chez les Égyptiens, les viscères étaient conservés dans des urnes ; dans l’attente des progrès chirurgicaux ? Chez les Incas, tout y est par contre, grâce au sel, je crois, ou pour quelque autre raison, peu importe ; mais dans quel état… J’aime les momies, vous comprenez, parce que je les plains… Je crois qu’ils étaient sur la bonne voie, mais il leur manquait… quoi donc ? Une idée, une technique, des moyens ? Tout faire pour conserver son corps dans l’attente du seul grand soir qui compte – et qui semble ne jamais devoir advenir –, pour arriver dans cet état ! Je dois vous avouer que je n’ai parfois pas résisté à la tentation de me moquer d’eux ; ainsi, une fois que l’idée m’était venue de dire que, d’une certaine manière, ils avaient été lyophilisés, j’ai plongé une splendide momie de chat à laquelle j’avais ôté les bandelettes dans une bassine d’eau chaude… un désastre. Je m’en suis terriblement voulu, et encore ne s’agissait-il que d’un chat…
Cela faisait plus d’une heure qu’il me parlait, d’une voix égale. Je l’avais suivi, docile, dompté par cette masse exceptionnelle qui avait choisi, un jour, de se moquer de tout sauf de ce qui nous attendait après la mort.
— Je ne vois pas pourquoi nos tristes semblables se préoccupent d’autre chose : vous-même, voyez où cela vous a mené… Même l’art est une coquetterie.
Il avait pointé un index moqueur vers un Rubens, un Cézanne, un Turner.
— L’art est une coquetterie et une vanité, parce que l’art est l’idée que des incapables se forgent sur le labeur des « artistes » pour se consoler de leur peur de la mort. Je ne crois pas que les artistes sérieux songent à l’art. Des gestes, mon cher, rien que des gestes, désespérés, impuissants… des gestes d’adieu, des gestes dans la chute pour se raccrocher à quelque chose… mais à quoi ? Au vent !
Puis, il me ramena dans son bureau et me montra un épais album empli de clichés, couleurs ou noir et blanc, les seuls vestiges de sa collection confisquée.
— Ils peuvent me les reprendre, reprit-il d’une voix grave, il n’empêche que je sais qu’elles étaient bien chez moi ; elles s’y savaient comprises, elles étaient à l’aise. Tandis que dans leurs musées… entourées d’insignifiants scientifiques qui se font une si haute idée de leur vie, de la vie, alors que celle-ci ne représente rien, ne serait-ce qu’en regard du parcours de ces momies… La vie se donnerait des droits sur ces morts, sur la mort, pour accroître d’illusoires connaissances ? Quelle erreur, quelle grotesque méprise !
Même en cet instant, je ne ressentis pas le moindre frisson, pas le plus infime tressaillement. Il se tut pendant que j’achevais de feuilleter l’étonnant catalogue d’une collection dissipée. Glissées à la fin du volume, se trouvaient quelques coupures de presse relatant la découverte d’un corps miraculeusement conservé et retrouvé des milliers d’années plus tard dans les Alpes, ou de mammouths de Sibérie, ou consacrés aux techniques de cryogénisation développées par les Américains dans l’espoir de pouvoir rappeler à la vie, quand la médecine aurait accompli des progrès décisifs, des personnes mortes de maladies à ce jour incurables. Mais Kopf me laissa achever cette lecture sans autre commentaire. Lorsque j’eus achevé, je tentai de le fixer sans faiblir, mais lui demandai d’une voix mal assurée :
— Et qu’attendez-vous de moi ?
Je n’imaginais rien de précis, mais j’aurais pu laisser vagabonder mon imagination : partir dans le monde à la recherche de nouvelles momies, de procédés révolutionnaires… Cependant, mon esprit était comme figé, ce qui ne m’empêcha qu’en partie d’être déçu lorsque Kopf m’eut éclairé sur ce point :
— Je voudrais que vous soyez mon secrétaire particulier. Rien de plus. N’en ayant jamais eu, j’ignore en quoi consistera votre tâche dans les détails, mais je vous ai préparé un contrat le plus précis possible. Vous serez honorablement payé, et vous logerez ici ; en effet, je dois pouvoir toujours compter sur vous. Pour débuter, vous allez me chercher le meilleur architecte pour construire la demeure où je souhaite achever ma vie…
Et j’ai signé. C’est vrai que le contrat était d’une parfaite correction – j’étais assez compétent en matière de contrat véreux pour pouvoir repérer les autres –, et la rémunération excellente, supérieure même à ce que je gagnais officiellement avant ma condamnation. Cela n’explique pourtant pas mon adhésion à un être aussi fantasque, à un projet aussi vague, dans une atmosphère à la fois morbide et grotesque. Mais quoi, je l’ai déjà dit, j’étais séduit, ou hypnotisé – envoûté, qui sait. Dès le lendemain, je me suis mis en quête d’un architecte conforme aux attentes de Kopf. Il le voulait très compétent, imaginatif mais pas encore renommé. La tâche n’était pas simple. Je fréquentai les écoles d’architecture les plus réputées, questionnai les professeurs et les étudiants. Kopf me laissait toute latitude, mais me demandait tous les jours si je comptais aboutir sous peu. Je voulais le satisfaire, j’y mettais le zèle du jeune collaborateur ministériel que j’avais été, et la compétence acquise me permit, au bout de trois semaines, de lui soumettre une liste de dix noms : un Américain, un Japonais, deux Français, deux Anglais, un Allemand, un Algérien, un Chilien et un Chinois. Il examina la liste sans sourciller, se contentant d’opiner avec lenteur, comme s’il s’agissait d’une sélection de sommités.
— Parfait. Et comment allez-vous procéder, maintenant ?
Je répondis que mon idée était de les mettre au concours :
— Dites-moi quel genre de maison vous attendez d’eux, et nous opterons pour le meilleur projet, quitte à y apporter des modifications…
Après un silence, il hocha négativement la tête :
— Non. Nous ne préciserons pas mon attente. Départageons-les sur un projet plus anodin ; le test n’en sera que plus concluant. Demandez-leur le plan d’une maison sur pilotis, au bord de l’océan Pacifique…
Plus anodin… mais je ne discutai pas et écrivis en ce sens aux dix jeunes gens que j’avais repérés, leur demandant de réaliser dans les meilleurs délais un plan avec maquette que nous nous proposions de leur payer à un prix suffisant pour faire accroire le sérieux du défi.
Je fus fort désœuvré durant les semaines nous séparant de l’échéance que nous avions fixée aux candidats, mais Hermann Kopf ne parut pas s’en soucier. Il tenait à ce que je reste dans la pièce où il avait fait installer mon bureau.
— Familiarisez-vous avec votre ordinateur, puisqu’on dit que ces engins sont aujourd’hui indispensables, étudiez ma comptabilité, surveillez mes banquiers, veillez à ce que mes ordres de vente et d’achat soient scrupuleusement respectés… N’hésitez pas à me faire des suggestions de placement ; je les étudierai avec intérêt.
Sa gestion financière était exemplaire d’intelligence et de justesse, mais ce fut le seul domaine où je pus prendre un peu d’ascendant sur lui – je me rends compte à présent combien c’était futile. Je lui donnai quelques conseils qui s’avérèrent judicieux, et il me laissa rapidement gérer sa fortune, n’exerçant plus qu’une surveillance de principe.
Le jour fixé par l’appel aux candidatures, nous disposions de neuf projets – un des Français s’était désisté. Je les avais exposés dans une vaste pièce dont la principale décoration était un Whistler représentant une jeune femme assise devant une maison de planches. Kopf sembla apprécier cette attention, pour autant qu’il pût marquer de quelque manière sa satisfaction. Il observa avec minutie les maquettes, étudia les plans et les curriculum vitæ des candidats. Au bout d’une demi-heure, il me demanda ce que j’en pensais. J’avais pour ma part été très sensible au projet de l’Américain, sa maison réalisée essentiellement en verre m’attirait et me donnait l’envie de rapetisser pour m’y glisser. Je le dis à Kopf.
— Je vois. C’est pour ça que vous avez choisi Whistler. C’est de fait une réalisation très vivante… mais je choisirai l’Allemand. Faites-le venir le plus vite possible. Même si vous ne l’aimez pas.
Comment avait-il deviné ? C’était simple : j’avais, inconsciemment, placé cette maquette au bout de la table, dans l’ombre que jetaient sur elle ses voisines. C’était une demeure épaisse, qui mariait aussi l’opaque au transparent mais qui semblait plus faite pour résister aux impitoyables tempêtes que pour savourer les jeux de clartés sur l’océan…
Deux jours plus tard, Fritz von ** débarqua de Bonn. C’était un jeune homme plutôt agréable, au moral comme au physique, qui contrastait avec la rigueur de son projet. Mais je n’eus guère l’occasion d’approfondir mon analyse, qui dut en rester aux stéréotypes sur la race germanique, car Hermann Kopf l’accapara aussitôt. Il resta une semaine chez nous, passant ses journées et une partie de ses nuits avec Kopf, dans son bureau où ils se faisaient servir leurs repas. Je fus tenu à l’écart de toutes ces discussions, et en ressentis une sorte d’amère jalousie. Si j’avais su…
Le terrain sur lequel Kopf projetait de faire bâtir cette nouvelle maison se trouvait à quelques kilomètres de notre ville. Kopf en était propriétaire depuis plusieurs années. Fritz et lui étaient allés le visiter dès le premier jour ; pour ma part, je ne le découvris que le jour où les travaux débutèrent, et je ne dois cette visite qu’à mon insistance, un instant proche de la colère.
— Ne soyez pas vexé, mon cher, avait simplement répondu Kopf avant de m’y emmener. Je suis seul juge de ce que vous devez ou non savoir. Croyez-moi, vous pouvez me faire confiance. Mais puisque vous prenez des airs de vierge outragée, je vais vous montrer les lieux où nous irons bientôt nous installer. Car je compte que ces travaux soient rondement menés. Fritz dirigera le chantier, mais vous l’assisterez d’ici. Ne vous formalisez pas, je vous en prie : Fritz sera, durant ces quelques mois, un patron très aimable, et nous vous laisserons choisir le papier peint et les détails de finition de votre futur appartement.
Je n’avais qu’à obtempérer, et je ne le regrettai pas car Fritz se révéla, de fait, très agréable, contrastant heureusement avec l’impression que m’avait laissée son projet. Le travail fut en outre accaparant, en raison des exigences que Kopf avait posées tant pour la qualité que pour les délais.
Le lieu choisi pour la construction était peu accueillant, du moins à mon goût : une campagne uniforme, plantée de saules pleureurs et d’aulnes, parsemée de cours d’eau lents et étriqués qui échouaient dans des étangs ou des marais esseulés. Les voisins les plus proches étaient des fermiers établis à cinq kilomètres. Une route en mauvais béton desservait les champs avoisinants et longeait la propriété au sud. Mais bien que le lieu me déplût et que je ne susse rien du plan de ma prochaine demeure, j’acceptai sans rechigner l’idée d’y emménager bientôt ; le charme qu’exerçait Kopf ne faiblissait pas.
Pourtant, nos discussions se raréfiaient et portaient exclusivement sur les avancements des travaux ou sur la gestion de sa fortune, qui croissait à un rythme soutenu grâce à moi. À l’une ou l’autre reprise, je m’insurgeai timidement contre la décision qui m’empêchait de me rendre sur le chantier ou de connaître les plans.
— Allons, mon cher, ne faites pas l’enfant. Je vous l’ai déjà dit : à quoi sert le savoir ? Je vous envie : vous aurez la chance de découvrir la maison achevée, sans rien avoir à connaître des processus intellectuels et techniques qui auront mené à son exécution. C’est vrai, je vous envie…
Fritz restait aussi inébranlable que notre commun patron. Le jeune Allemand se passionnait pour ce travail, c’était visible, mais cette fougue était contrôlée et ne le poussa jamais à une confidence, malgré mes essais répétés. J’aurais pu envisager de prendre ma voiture et de me rendre, en cachette, au chantier ; mais outre le fait que Kopf ne me laissait presque aucun répit durant la journée et qu’il m’était pour ainsi dire impossible de quitter la maison sans devoir rendre compte de mes déplacements, une crainte étrange m’en retenait plus efficacement que toute mesure de surveillance. J’en aurais d’ailleurs été pour mes frais : comme je le découvris plus tard, on avait d’abord bâti l’énorme mur d’enceinte et l’accès au chantier, invisible de la route, était surveillé jour et nuit.
Kopf m’enviait : j’avais, au début, pris cette remarque pour une ironique figure de style. Mais je compris petit à petit combien elle était fondée. Au fur et à mesure que le chantier avançait, Kopf se métamorphosait. Et ce n’est qu’alors que je pris conscience qu’il devait être âgé, tant il parut vieillir durant ces semaines. À quoi s’attelait-il vraiment ? Que recherchait-il dans cette nouvelle construction, alors qu’il possédait une des bâtisses les plus remarquables de la ville ? Je ne puis prétendre aujourd’hui que je m’inquiétais : je notais le changement sans rien comprendre ni rien imaginer. Même cette soudaine manie du secret, chez lui qui me semblait avoir toujours agi dans la transparence – sauf pour ce qui concernait ses momies –, ces attitudes mystérieuses ne me parurent pas effrayantes. Kopf l’avait bien noté : je réagissais comme un gosse, jaloux et envieux, contraint d’attendre Père Noël jusqu’à l’heure fixée.
Et lorsque, moins d’un an plus tard, le maison me fut enfin dévoilée, mon étonnement, qui avait été si habilement préparé, fut tel qu’il ne franchit pas le seuil de l’intelligence et que je demeurai jusqu’au bout dans cet émerveillement que je ne puis à présent que qualifier d’imbécile.
Un matin donc, sans que rien n’ait pu m’indiquer, les jours précédents, que le terme approchait, Kopf vint me chercher.
— Venez, mon cher ; nous allons choisir la couleur de votre papier peint !
Il semblait d’excellente humeur, à savoir qu’un pâle sourire nimbait ses traits épais. Nous montâmes dans la limousine qui nous mena devant l’imposant mur d’enceinte, surmonté de fils barbelés que je devinai électrifiés. Une lourde porte métallique glissa, silencieuse. Je trépignais sur place, tentant de deviner, par dessus l’épaule du chauffeur, le spectacle que la porte dévoilait avec trop de lenteur. J’en fus encore pour mes frais, car nous nous engageâmes sur une longue allée, bordée d’un terrain où l’on venait de semer la pelouse et de planter des arbustes décoratifs et de ifs, allée qui paraissait plonger à l’horizon. Et de fait, après trois cents mètres, le terrain s’enfonçait brusquement ; c’est là que je découvris cette invraisemblance qui m’apparut cependant comme une évidence : une énorme pyramide marmoréenne, percée de larges fenêtres et dont la pointe consistait en une énorme verrière.
Fritz, à mon grand étonnement, avait réalisé une merveille de légèreté et de luminosité, grâce sans doute à Kopf. Même aujourd’hui, malgré tout ce qui s’est passé depuis, je ne puis songer à cette demeure sans passion. J’ai adoré cette maison exceptionnelle pour elle-même d’abord, puis pour celle qui allait venir l’illuminer encore davantage. Et maintenant…
— Ne croyez pas, mon cher, que je me prends pour un Président, ni même pour un Pharaon ! Je n’en suis même pas la synthèse ; il n’y a pas en la matière de voie médiane. Il n’y en a d’ailleurs jamais, hormis pour les médiocres. Tel est le lieu de la mort vivante, transfigurée ! C’est ici que je finirai mes jours, cher ami, à vos côtés je l’espère, car vous m’êtes d’un grand secours.
Je ne compris pas cette dernière affirmation, mais je n’y réfléchis guère : j’étais une fois de plus subjugué. Nous nous trouvions dans le vestibule en forme de T, qui partait de l’entrée au sud, prenait fin au milieu de la pyramide en se prolongeant à gauche et à droite jusqu’aux murs est et ouest. Un puits de lumière reliait directement ce rez-de-chaussée au sommet translucide. Des dizaines de pièces s’agençaient dans cette pyramide suivant une logique impénétrable ; même après y avoir vécu plusieurs mois, je n’en pus jamais percer tous les secrets. Mais n’est-ce pas le propre d’une pyramide ? Le plus étonnant avec celle-ci était que l’on n’avait pas conscience, une fois que l’on se trouvait à l’intérieur, de la structure particulière de la construction ; pas un mur, pas une fenêtre ne trahissait l’inclinaison des parois et même l’énorme pointe lumineuse déjouait l’observateur par un jeu subtil de verre, de glaces et de reflets. Des escaliers de toutes sortes – longs ou courts, larges ou étroits, droits ou en colimaçon – achevaient de vous perdre. À l’exception de Kopf et de Fritz, chaque habitant de cette demeure allait finit par n’acquérir qu’une connaissance relative du labyrinthe en fonction des déplacements que sa tâche spécifique lui imposait. Pour ma part, je ne mis jamais les pieds dans la cuisine, dans ce que l’on appelait autrefois les communs ; je trouvais sans difficultés le chemin de mes appartements, qui se trouvaient au deuxième (mais la notion d’étage est toute relative dans cette construction), à l’est. Je disposais d’une grande chambre, d’un salon très raffiné, d’une salle de bains équipée des gadgets les plus récents et les plus agréables, et j’accédais directement à mon bureau, lequel, grâce à l’informatique, me permettait de me connecter avec le monde entier – et d’une certaine façon, je finis par mieux connaître le réseau mondial que la maison où je vivais.
Pourtant, rien d’inquiétant n’émanait de cette extraordinaire construction – au contraire. Même Kopf, sous son masque impavide et imposant, semblait serein. Le parc était magnifique ; Kopf avait porté un soin égal pour le faire dessiner.
— À considérer la vie comme un fulgurant accident, avouez que la majorité d’entre nous sommes appelés à passer un temps infiniment plus long dans les jardins qu’entre les murs, fussent-ils les plus beaux et les plus confortables.
Nous nous étions donc installés. Les premières semaines furent très absorbantes : il me fallut veiller au déménagement – du moins pour la partie que Kopf m’en avait confiée, lui-même se chargeant de l’essentiel, que ce soit pour la disposition dans les nouveaux lieux que pour l’achat de meubles complémentaires, la maison étant plus vaste. Je ne remarquai même pas la disparition de Fritz, et lorsque je finis par y songer, cela me parut normal puisque sa tâche était accomplie. J’avais donné l’ordre de virement pour sa rémunération, tous les corps de métier avaient été payés comptant, mais les millions investis ne troublèrent même pas la surface de la fortune de Kopf. Enfin, tout fut en place. J’avais effectivement pu choisir la décoration de mes appartements et j’avais opté pour une décoration dans le plus pur style campagnard anglais, alors que les autres pièces que je connaissais étaient toutes dans un style moderne plutôt froid mais très raffiné : c’était une des marques du génie de cette folle construction, que tous les styles auraient pu y cohabiter en harmonie – ou plutôt, dans la plus complète indifférence.
La vie reprenait un cour calme, routinier. Je gérais les comptes de Hermann Kopf, j’accomplissais scrupuleusement les menues tâches dont il me chargeait à l’occasion – et jamais je ne m’étonnai de cette situation qui voulait que je sois largement rétribué pour un travail somme toute presque subalterne. Qu’attendais-je ? Que Kopf me confie quelque secrète et terrible mission destinée à change la face de la vie – ou de la mort ?
Deux événements rapprochés auraient pu accréditer pareille idée, si je l’avais eue.
Le service de la maison était assuré par le même vieux couple qui présidait au quotidien de l’ancienne résidence – revendue à un prix excellent, sans que Kopf parût s’émouvoir ni de la somme ni de la perte d’une maison où il avait pourtant vécu de si longues années. Ces deux vieillards supportèrent beaucoup plus mal la séparation : eux qui, jusqu’alors, se confondaient avec l’ombre des lieux, se mirent à se cogner partout, à maugréer. La qualité des repas s’en ressentit, et Kopf marqua son désagrément ; ils eurent des discussions que je devinais vives, mais auxquelles je n’assistai pas. J’ignorais encore à quelle accord ils étaient arrivés tous les trois, lorsque Kopf m’informa de façon assez évasive de la venue prochaine d’un de ses anciens amis ; quant à moi, il aurait une mission importante à me confier. Les jours qui suivirent, Kopf sembla retrouver l’ardeur qui avait été la sienne durant la construction de la pyramide. Un matin, au terme du petit déjeuner que nous prenions toujours ensemble dans une pièce du bas qui donnait à l’ouest, sur le parc et un étang bordé de roseaux, Kopf se leva d’un bond à la sonnerie d’entrée, déclenchée à la porte de la propriété. Il me commanda d’un ton sec d’ouvrir notre forteresse et d’aller ensuite l’attendre dans mon bureau. Je traînai dans les escaliers et pus ainsi l’observer qui accueillait un étrange personnage vêtu d’un uniforme kaki, coiffé d’un keffieh palestinien, et que dans mon esprit j’assimilai aussitôt, quoique sans motif particulier, à un terroriste.
Kopf me rejoignit peu de temps après.
— L’ami que j’attendais est arrivé. Nous avons du travail à effectuer ensemble, qui nous prendra une bonne quinzaine de jours. Par ailleurs, mes domestiques m’ont signifié leur intention de quitter mon service : ils sont trop âgés pour s’adapter à ce style de demeure, et les nouveaux propriétaires de mon ancien hôtel ont formulé le souhait de les garder ; j’accède volontiers à cette double demande, car cette demeure-ci nécessite un personnel particulier. C’est la mission que je vous confie, mon cher : vous partez demain matin pour le Caire, où une de mes relations vous attend et vous aidera à recruter trois couples de domestiques. Voici une enveloppe avec les renseignements nécessaires. Non, pas un mot : ne craignez rien pour les formalités d’immigration, tout est arrangé. Vous n’aurez qu’à communiquer l’identité des six personnes que vous sélectionnerez à notre ami égyptien, et ils pourront revenir avec vous dans deux semaines ; même les places dans l’avion sont réservées.
J’eus un mouvement qu’il interrompit d’un geste péremptoire :
— Pas de question, et pas d’inquiétude. Je saurai me débrouiller pendant quinze jours, bien que vous me soyez devenu indispensable en de nombreuses matières. Je vous laisse. Je ne dînerai pas avec vous ce soir. Faites un bon voyage et profitez-en pour visiter les autres pyramides, là-bas ; mais vous verrez, celle-ci est de loin plus agréable, et pas moins intéressante.
Et je me retrouvai le lendemain dans l’avion à destination du Caire, toujours abasourdi.
S’ouvre ici la partie la plus désagréable de ma narration, car je vais devoir parler de moi, de mes sentiments. J’y suis contraint, cependant ; si je ne m’étais pas mêlé d’intervenir directement, les choses auraient pris une autre tournure. Pourtant, non, Kopf n’aurait pas agi autrement, à un détail près, et de taille, qui m’a sauvé la vie et condamné au remords.
L’ami de Kopf, Nasser, m’attendait comme prévu à ma descente de l’avion. Il m’accueillit avec beaucoup d’affabilité ; c’était un homme d’une cinquantaine d’années, assez fort, volubile à l’extrême et qui parlait assez bien le français – hélas ! Il me conduisit dans un palace du centre et pendant l’interminable trajet, il essaya de m’expliquer comment il envisageait de m’aider dans ma tâche. D’abord, je pourrais consulter les dossiers de soixante couples qu’il avait présélectionnés. Je pourrais aussi les rencontrer. Et surtout – car cela parut comme le plus important à ses yeux –, je devais visiter en toute tranquillité le pays des Pharaons ; je ne repartais que dans quinze jours et il n’en faudrait pas plus de trois pour choisir des domestiques. Je ne songeai pas une fois qu’il était évident que Kopf avait voulu m’éloigner et qu’il était grotesque de venir en Égypte choisir des domestiques qui, en outre, ne parleraient pas un mot de français. Non. Tout me semblait normal, dès que Kopf le demandait ou le prévoyait de la sorte.
Je ne m’étendrai pas sur mes visites et mes impressions ; elles sont dépourvues de tout intérêt, confondantes de banalité, identiques à celles que quiconque éprouve en suivant un reportage sur le Nil légendaire. Je mesurai l’influence que Kopf exerçait sur ma vie : je restai plutôt indifférent à ces sites, reportant sans cesse mes pensées à notre pyramide du nord. Je resongeais à la première – et dernière – discussion que Kopf et moi avions eue au sujet des Égyptiens :
— Regardez ces efforts gigantesques, démesurés pour s’assurer un lambeau d’éternité ! Je les aime, mes Pharaons, et en même temps ils me font pitié : n’avaient-ils pas en main tout pour réussir ? Ne s’agirait-il que d’un problème technique ?
De retour au Caire, je rendis visite à Nasser. Il habitait une somptueuse villa qui avait appartenu à des officiers anglais, et qu’il avait adaptée au confort moderne et à ses théories de gadgets. J’arrivai au moment où retentissaient les cris d’une dispute en arabe ; la porte qui s’ouvrit me dévoila un Nasser bien différent de l’homme affable qu’il était envers moi, prêt à battre une jeune femme roulée en boule à ses pieds. Je ne pus contenir un cri ; il s’interrompit, surpris, et son geste retomba dans le vide alors qu’il retrouvait son sourire – que je jugeai du coup obséquieux – pour m’accueillir.
— Mon ami ! Excuse-moi, cette incapable me désobéit sans cesse. Je vais me débarrasser d’elle…
C’est alors que la jeune femme releva la tête, que je vis son regard, d’une incroyable dureté, mais aussi d’une telle splendeur… Elle affrontait avec fermeté son patron, sans se soucier de moi, moi qui ne pouvais plus défaire mes yeux de cette éblouissante créature… Jamais je n’avais rencontré un type physique pareil… ô ! que j’envie les écrivains qui savent trouver mots et images pour décrire de telles apparitions, de telles beautés ! Moi, je ne le puis. Ou ne le veux, qui sais comment les événements ont tourné.
Nasser aussi avait remarqué mon saisissement. D’un geste brusque, il fit disparaître la jeune femme et me prit par le bras pour me conduire dans son salon.
— Oh là, mon ami, prends garde ! Cette fille est belle, sans doute, mais c’est une furie, une insoumise. Elle est d’une origine étrange, ni juive ni arabe, ni rien de ce que nous connaissons. Elle songe plus à ses deux enfants qu’à son travail, et n’a qu’un maître : les profondes rêveries où elle sombre trop souvent. Demain, tu verras, je te présenterai de bons domestiques. Tu n’auras que l’embarras du choix.
Je tâchai, maladroitement, de sauver la face mais, au moment de repartir après un thé cérémonieux et grave, je ne pus m’empêcher de lui demander :
— Je voudrais la revoir.
— Qui donc ?
— La jeune fille.
— Fiona ?
Il me scruta longuement puis, avec un sourire équivoque :
— Bien, bien, je vois… D’accord, mon ami, d’accord. Je lui dirai de venir à ton hôtel ce soir. La chienne a intérêt à m’obéir, ainsi qu’à toi…
Je voulus protester contre ses ignobles insinuations mais il me poussa vers le taxi que j’avais fait appeler, avec des gestes trop amicaux.
— Ne t’en fais pas, mon ami, je comprends, je comprends parfaitement… Ce soir, Fiona sera chez toi !
Il m’assit de force, referma la portière, donna l’adresse au chauffeur et me regarda m’éloigner avec son répugnant sourire. Qu’est-ce que cet idiot était allé imaginer ! Une fois dans ma chambre, je voulus lui téléphoner pour m’expliquer, pour tout annuler, mais quelque chose me retint. Quoi ? La peur d’être ridicule ? L’irrésistible envie de la revoir malgré ce que Nasser pouvait imaginer ? J’espérai alors, devant mon impuissance, que ce que Nasser m’en avait dit serait exact, qu’elle se montrerait assez insoumise pour refuser ce rendez-vous devenu sordide par la faute de cet entremetteur. Mais à vingt heures, un appel de la réception m’avertit qu’une jeune femme était arrivée. Je faillis répondre qu’elle pouvait monter, mais j’imaginai le concierge afficher le même sourire entendu que Nasser et je répondis que j’arrivais.
Cette démarche eut le mérite d’imprimer sur le visage sévère et colérique de Fiona une nuance de perplexité qui la rendit plus douce, plus fragile. Je réalisai alors dans quel jeu je nous avais embarqués, sans lui demander son avis, jeu qui pouvait devenir si cruel s’il ne devenait pas réalité. Je la pris délicatement par le bras et l’entraînai vers le bar de l’hôtel, en lui murmurant de ne pas s’inquiéter. Devant ses yeux où la peur revenait, je me rendis compte que je lui avais parlé en français et que je ne savais même pas si nous partagions, même imparfaitement, une langue qui me permettrait de lui faire comprendre la sincérité de mes intentions. J’essayai aussitôt en anglais et fus soulagé de la découvrir qui se calmait un peu. Elle me suivit et s’assit face à moi, impressionnée par un endroit qu’elle n’avait jamais dû fréquenter, et dont ce versant-ci du luxe lui était interdit. Son malaise fut plus vif encore lorsque le garçon vint prendre notre commande, non sans un regard dédaigneux vers cette femme trop belle et trop mal habillée pour être honnête. Du bout des lèvres, elle demanda un verre d’eau ; pour faire bonne mesure, je choisis un whisky – aussi pour me donner courage.
Je tentai ensuite d’accrocher son regard, mais elle gardait ses somptueux yeux gris baissés vers la table, dans l’attitude d’un animal sauvage contraint de feindre la soumission. Je devais parler, sans quoi je devinais qu’elle ne bougerait pas et qu’elle repartirait – que plus jamais je n’oserais l’approcher. Je lui expliquai alors, d’une voix mal assurée, que j’étais désolé, que je n’imaginais que trop bien la manière dont Nasser avait dû présenter ma demande ; pourtant, elle ne devait rien craindre, au contraire. Je redoutais d’imaginer les menaces auxquelles il avait dû recourir pour la décider à venir. À ce moment, elle releva la tête et me regarda, incrédule. Je découvris alors combien son air farouche recouvrait d’angoisse, lorsqu’elle répondit d’une voix imperceptible :
— My children…
Ses enfants… Cet ignoble individu avait dû menacer ce qu’il m’avait dit compter le plus pour elle… Je m’en voulus encore et, sans plus réfléchir, je lui proposai de quitter l’Égypte pour venir chez nous, avec ses deux enfants ; je pouvais lui offrir un bon travail, dans un pays où ses droits seraient reconnus, où personne ne pourrait exercer de chantage sur elle… Je m’emballais et elle m’écoutait parler, ses yeux durs fixés sur mes lèvres, le visage tiré, se demandant sans doute quel genre d’homme j’étais, quel nouveau type de cruauté j’étais en train d’expérimenter… Je m’interrompis brusquement.
— You don’t believe me, do you ? dis-je d’une voix pleine de rage impuissante.
Une flamme traversa ses yeux, les coins de sa bouche se mirent à trembler et cet être imprévisible sembla, soudain, abandonner sa méfiance :
— Not the words… just the sound of your voice… I believe you…
Avait-elle le choix ?
Je voulus la laisser repartir aussitôt qu’elle eut achevé son verre, mais elle eut un geste de refus qui me surprit :
— Not now… too soon… Nasser… let him believe what he wants, or he will suspect something else…
Elle se montrait à présent très sûre d’elle, déterminée ; le sort en était jeté, pour elle comme pour moi, mais avec des enjeux à ce point différents que la comparaison était injuste, sinon injurieuse.
Je me sentais tout à coup ridicule et elle le perçut, qui eut un petit rire dont elle s’excusa aussitôt en baissant les yeux, comme une vie de servitude le lui avait appris. Je voulus la rassurer ; j’aimais ce rire limpide, miraculeux. Pour tenter de décrisper cette situation artificielle, je me mis à parler de moi, de mon métier – et je réalisai qu’il n’y avait pas grand-chose à dire ; je lui expliquai son futur travail dans les grandes lignes, pour ne pas l’effrayer par l’évocation trop précise des excentricités de Kopf qui auraient pu rappeler un pays que je lui proposais de fuir. Puis, je lui demandai de me parler d’elle, de ses enfants – j’allais poursuivre en évoquant ces sombres rêveries dont avait parlé Nasser, mais je m’arrêtai à temps. Ma question la rejetait dans une attitude tendue, défensive, et je dus user de toutes les précautions dont j’étais capable pour la rasséréner ; en tout état de cause, je ne parvins à lui arracher que quelques phrases lapidaires. Elle avait bien deux enfants, un garçon prénommé Aadji, qui venait d’avoir dix ans, et une fillette de huit ans, Loan. Elle m’assura, empressée, qu’ils travaillaient déjà et que je pouvais compter sur eux ; elle fut visiblement abasourdie lorsque je lui expliquai qu’il n’en serait pas question et qu’ils iraient à l’école comme tous les enfants de mon pays. Elle me dévisagea avec attention pour s’assurer que je ne me moquais pas d’elle ; la perspective de l’école pour ses enfants était sans aucun doute une terre promise à ses yeux, un rêve inaccessible. Qu’étais-je en train de promettre ? Que ferais-je si Kopf s’opposait à ce dessein ? Je réussis toutefois à masquer mon inquiétude : au point où nous en étions, je n’avais pas le cœur à ternir ce bonheur inespéré. Je me voulus confiant, pour ne pas m’avouer lâche.
À son sujet, je n’appris rien. Quand je tentai à nouveau de la faire parler d’elle, elle détourna la conversation, ou plutôt la laissa sombrer après avoir affirmé qu’il n’y avait rien à dire sur son compte sinon que, à condition de ne pas se comporter comme Nasser, elle travaillait sans rechigner. Cette dernière phrase me plongea dans une désagréable réflexion ; je n’imaginais que trop les mœurs et les assauts de cet homme qui, depuis ce matin, me répugnait. Je ne demandai toutefois aucun détail à Fiona – je savais qu’elle ne m’en aurait pas donné. Mais je ne pus me retenir de la questionner sur ces origines mystérieuses qu’avait évoquées Nasser, et que les sonorités particulières de leurs prénoms suggéraient. Erreur ; son visage s’empourpra et elle me répondit avec colère :
— Forget what Nasser told you ! Nasser knows nothing ! No matter where we come from ; we come from a dream that turns to nightmare…
Elle se leva.
— Now, I can go home.
Puis, se calmant, effrayée peut-être à l’idée de gâcher la chance que je représentais, elle me pria d’excuser son éclat. Tout ce qui venait de Nasser l’horripilait. Elle me supplia encore de ne plus la questionner sur son passé, sur leurs origines, et je la raccompagnai jusqu’à l’entrée de l’hôtel où je voulus lui offrir un taxi, qu’elle refusa. Je la regardai s’éloigner dans la nuit cairote sans se retourner.
Nous venons d’un rêve qui a tourné au cauchemar… cette phrase me tarauda toute la nuit ; apportais-je la fin du cauchemar, ou le début d’un nouveau ? N’existait-il pas des cauchemars dont on ne pouvait plus jamais sortir ?
Le lendemain, après un mauvais sommeil, je commençai par appeler Kopf pour lui demander l’autorisation de modifier le projet initial. Je tentai de ne pas laisser transparaître mes sentiments, insistai sur l’excellente impression de sérieux que Fiona m’avait laissée, noircis le portrait de Nasser et évoquai le plus vite possible le problème des enfants. Kopf m’avait écouté sans intervenir et il laissa le silence se prolonger lorsque j’eus achevé. Puis, sa voix grave retentit :
— Je vois, je vois… Vous semblez accorder au cas une grande importance… Je suppose que vous savez ce que vous faites, mon cher. Dites à votre protégée qu’à trois, ils devront travailler pour deux, malgré l’école des enfants… J’assumerai tous les frais. Trouvez deux autres couples plus… anodins, et dites à Nasser de tout arranger.
Kopf perçut-il le soulagement qu’il m’apportait ? Qu’avait-il deviné ? Peu importait, Fiona et ses enfants étaient sauvés, et je l’aurais à mes côtés… Chez nous, n’aurais-je pas tout le temps d’apprivoiser cet être farouche ?
Requinqué, je me rendis chez Nasser, redoutant néanmoins de devoir affronter cet individu. Il m’attendait et m’accueillit avec ce même sourire obséquieux qu’il avait en me quittant la veille.
— Alors, mon ami, comment s’est passée notre petite soirée ? Tu as réussi à dompter le fauve ?
Je me retins de lui dire ce que je pensais et, d’un ton aussi froid et ferme que possible – mon passage dans le monde politique me servait –, je lui exprimai mon souhait de compter Fiona et ses enfants parmi les personnes que j’engageais et que je ramènerais en Europe. Il me dévisagea sans perdre tout à fait son sourire vicieux ;
— Tu n’y songes pas… Je te l’ai dit, elle est insoumise… et ses enfants ne sont bons à rien… Kopf ne sera pas d’accord…
Je lui rétorquai sèchement que Kopf m’avait donné carte blanche et que je disposais de son accord ; il ne lui restait plus qu’à régler le problème du billet d’avion supplémentaire et des formalités d’immigration.
Nasser obtempéra et je ne tentai même pas de le convaincre qu’il se trompait sur mes motivations. Durant les quelques jours qui restaient avant notre départ, je choisis deux couples « anodins », comme l’avait suggéré Kopf, et je ne revis plus en tête à tête la belle Fiona. Chaque fois qu’elle apparaissait dans la pièce où Nasser et moi travaillions, l’Égyptien me décochait un clin d’œil et répétait immanquablement, lorsque la porte se refermait :
— Tu sais ce que tu fais, mon ami, tu sais ce que tu fais…
Il tint à me présenter les enfants, que Fiona fit venir sans mot dire ; ils se tinrent aux côtés de leur mère, muets, figés dans cette sauvage dignité qui semblait se moquer de tous les esclavages. Ils avaient les mêmes yeux gris qui me transperçaient et semblaient me nier, tel un obstacle de verre à peine poli. La présence de Nasser m’empêcha tout geste de tendresse ou ne serait-ce que de sympathie, et je me contentai de dire à Fiona que tout était arrangé comme que je lui avais promis. Il y eut une brève lueur de reconnaissance dans ses iris qui, par chance, échappa à Nasser.
La veille de notre départ, je surmontai le dégoût que j’éprouvais à présent pour mon hôte et j’essayai de le questionner sur les origines de Fiona, malgré ce qu’elle m’avait répondu, ou peut-être pour cette raison.
— Elle ne t’a rien dit ? Ça ne m’étonne pas. D’après ce que je sais, elle appartient à une peuplade ou une tribu très ancienne, à peu près disparue aujourd’hui, sans laisser la moindre trace… Un jour qu’elle était en colère, une fois de plus – je t’ai prévenu, mon ami, tu n’as pas fait une affaire ! –, elle m’a balancé que personne ne pourrait jamais souiller l’âme de Maramisa…
— Maramisa ?
— Oui. D’après ce que j’ai compris, ce serait le nom de la ville ou du royaume perdu de cette tribu. Quelques vieux à qui j’en ai parlé connaissaient vaguement ce nom, sans pouvoir me dire où ce lieu se situait. Rien d’intéressant, mon ami : pas de trace, pas une pyramide, pas un livre ! Rien que des folles comme Fiona ! Je te le dis, Maramisa, pour moi, c’est le nom d’un asile de cinglés !
Et il éclata d’un rire satisfait.
Aujourd’hui que je me retrouve, impuissant et solitaire dans notre pyramide, je revois ces premiers jours en Europe, après un voyage durant lequel mes sept passagers n’avaient pas desserré les dents, effrayés sans doute par l’avion qu’ils découvraient. L’accueil de Kopf, toujours aussi glacial, n’avait pas contribué à détendre mes protégés. Il est des terres d’Égypte cerclées de Mers Rouges infranchissables, où la voix de Dieu se perd dans le néant du désert…
Irais-je au bout de ma honte, Fiona, pour implorer ton pardon ?
Kopf nous attendait sur le seuil de la pyramide. Dans la première voiture, où j’étais monté avec Fiona et ses enfants, j’avais tenté de préparer mes passagers au choc qu’ils éprouveraient sans doute en découvrant la maison. J’avais lourdement insisté sur la luminosité de cette pyramide-ci, et je n’avais pas mentionné les idées jouait sur la mort et la vie avec lesquelles Kopf jouait. Pour me convaincre que je n’avais pas commis la plus funeste erreur de mon existence, je me dis que tout valait mieux que la fréquentation de Nasser, et j’évoquai l’inscription à l’école des enfants. Mais aucun d’entre eux n’ouvrit la bouche durant le trajet et le regard que me décocha Fiona, farouche et fier malgré la peur, m’incita à cesser là ma verbosité.
J’étais tellement préoccupé par l’accueil que nous réserverait Kopf que je ne songeai plus à son étrange visiteur ; ce n’est que plus tard dans la journée que je réalisai qu’il avait disparu.
Kopf me stupéfia en s’adressant aux sept nouveaux venus en arabe, ce qui ne les surprit pas moins. Ils étaient intimidés par ce géant européen à la peau trop blanche et trop grasse, qui leur parlait dans une langue qui semblait incompatible avec sa fonction. Seule Fiona se maîtrisa, et je vis que Kopf ne la quitta jamais longtemps de ses yeux enfouis dans les replis de ses paupières. Que pensait-elle ? Que je la livrais à un autre Nasser ?
Kopf ne laissa pas s’éterniser l’arrivée ; il s’enquit auprès de moi de la qualité du vol puis, sans même attendre que j’ai achevé une réponse insignifiante :
— Bien, mon cher. Montez vous reposer, vous devez être fatigué, tout comme ces gens. Je vais leur montrer leurs logements et les pièces qu’ils doivent connaître. J’ai pris les dispositions pour les enfants : demain, le directeur de l’école voisine, qui Dieu merci parle anglais, viendra voir avec leur mère et eux-mêmes quel est leur niveau et en quelle année il convient de les inscrire. C’est une bonne école, et l’homme me semble dévoué. Nous dînerons ensemble ce soir.
Sans poursuivre, il me congédia d’un geste et entraîna son petit monde vers des lieux de la pyramide que je ne connaissais pas, qui m’étaient interdits par une loi tacite que je n’ai jamais songé à transgresser.
À vingt heures, nous nous retrouvions, comme de coutume, dans la salle à manger. Fiona et sa fille firent le service, silencieuses. J’essayai de capter le regard de Fiona, mais en vain. Elle semblait calme, soumise, presque heureuse, mais elle évita avec soin de me regarder. Je sentais Kopf qui nous épiait, sans mot dire, malicieux ou seulement curieux.
Quand nous fûmes seuls, découvrant les saveur particulières et délicieuses que Fiona avait accommodées pour nous :
— Vous avez eu raison, très cher : c’est une excellente cuisinière. Les quatre autres se répartiront les charges de la maison et du jardin. Elle régnera sur les cuisines, et ses enfants l’y aideront lorsque ce sera nécessaire. Nasser est de fait un idiot d’avoir voulu vous dissuader de la ramener. Savez-vous qu’il m’a téléphoné peu de temps après vous, pour s’assurer que vous ne le bluffiez pas et pour tenter de me faire changer d’avis ? Quoi qu’il vous en ait dit, il doit regretter d’avoir perdu une aussi ravissante créature qu’il ne désespérait peut-être pas tout à fait de dompter… Mais je pense qu’il n’est pas le seul à être sous le charme…
Je ne répondis rien, mais je savais mon trouble éloquent.
Les semaines qui suivirent furent pour moi un véritable calvaire. Kopf s’arrangea-t-il pour qu’il en soit ainsi ? Je ne le pensais pas au départ – mais à présent ? Je ne parvenais à voir Fiona que pendant les repas ; le reste de la journée, quand je n’étais pas occupé, je rôdais dans les pièces qui composaient mon espace réservé, j’espérais qu’elle survienne ; je ne l’y croisai jamais. Ses enfants allaient à l’école, mais je ne les voyais ni partir ni rentrer. Tous trois faisaient des progrès magistraux en français, alors que les quatre autres domestiques – ceux-là, il me semblait qu’ils traînaient toujours dans mes pieds ! – en restaient à un sabir vaguement anglais. Je n’avais d’ailleurs rien à leur dire : Kopf avait pris en main le fonctionnement de la maison, me confirmant dans mes tâches de gestion financière – travail absorbant dont je m’acquittais avec un mérite qu’il reconnaissait volontiers.
— J’ai passé une vie à bâtir une fortune ; quelques mois vous suffisent pour la doubler.
Mais c’était à présent son seul signe d’amitié – le mot a-t-il un sens pour Hermann Kopf ? Il ne me parla plus jamais des momies, ni même de sa pyramide et de ses secrets. Je ne pus rien savoir du visiteur qui m’avait « chassé » en Égypte. Lorsque j’interrogeai Kopf, il répondit, laconique :
— Le savoir, mon cher ; souvenez-vous de ce que je vous ai dit : le savoir nuit. Imaginez.
Les repas m’étaient plus pénibles encore, car alors je voyais Fiona mais ne pouvais lui parler. Puéril, j’essayais de frôler sa main lorsqu’elle me servait, mais elle conservait à mon égard cette distance qu’elle affichait depuis son arrivée. Un soir, alors que nous venions d’être servis et que Fiona nous quittait et me laissait vaincu une fois encore, Kopf me fixa avec un regard dur que je ne lui connaissais pas encore, et qui rappelait celui de Fiona.
— Vous vous rendez malheureux, mon cher. Fiona n’est pas pour vous, ni pour vous ni pour personne. Elle porte dans son sillage un secret qui la rend inaccessible aux mortels.
— Qu’en savez-vous ? demandai-je d’une vois tremblante. Vous a-t-elle parlé de Maramisa ?
— Maramisa ? Non. Jamais entendu ce nom. Elle ne m’a d’ailleurs jamais parlé, si cela peut vous tranquilliser. Je vois, je sens. Je n’ai pas passé des années à observer des momies en vain ; j’ai appris à lire des signes qui ne trompent pas. Et je vous le dis : n’y pensez plus, ou vous serez éternellement malheureux. Et vous devinez que, pour moi, l’éternité n’est pas un concept vague.
Mais qu’y pouvais-je ? Je l’aimais, comme un collégien stupide ! Et que savait-il, Kopf, le fou, le génial Hermann Kopf ? Des étoiles naissaient, d’autres mouraient en engloutissant dans leur trépas des quantités infinies d’étoiles voisines ; pourquoi ne parviendrais-je pas à capter l’attention, le cœur de Fiona ?
Il me fallut attendre six mois pour les revoir tous les trois sans personne pour brouiller notre rencontre. Nous étions en décembre. Un neige abondante était tombée durant la nuit et le parc m’apparut plus splendide que jamais lorsque je le découvris à mon réveil. Il était tôt. Je décidai d’aller me promener avant le petit déjeuner. Soudain, du côté de l’étang, je perçus des bruits, des voix et des rires enfantins, doublés de la voix grave de Fiona qui s’était si naturellement adaptée aux sonorités du français. Le cœur battant, je me dirigeai dans cette direction, et je les découvris sur les berges de l’étang. Les enfants jouaient avec la neige et s’étonnaient de découvrir l’eau gelée ; leur mère les regardait, sereine, en les invitant de temps en temps à la prudence. Mon apparition figea rires et jeux ; puis, les enfants, sans hésiter, s’éloignèrent de quelques pas et reprirent leur découverte de la neige. Fiona me laissa approcher jusqu’à ses côtés, son regard paraissait détendu, ou résigné.
— Fiona, je…
Moi qui avais rêvé à cet instant depuis si longtemps, je me retrouvais paralysé comme un jeune prétendant !
— Merci, dit-elle, calme, dans un français presque sans accent, mais avec le chant grave qu’elle mettait dans ses rares phrases, quelle qu’en soit la langue.
— De… de quoi ?
— Merci pour nous avoir fait venir ici. Les enfants sont heureux. Grâce à vous, ils auront peut-être un meilleur avenir.
— Et vous ?
— Moi ?
Elle me dévisagea avec cette même incrédulité que lorsque je lui avais demandé au Caire de me parler d’elle.
— Il n’y a toujours rien à dire à mon propos. Mes enfants. Cela seul compte. Il ne faut pas penser à moi.
Je tremblais.
— Mais je pense à vous, Fiona. Du matin au soir.
— Il ne faut pas, répéta-t-elle d’une voix égale, ni chaude ni froide.
Un klaxon retentit et les enfants se mirent à courir vers la pyramide.
— C’est l’heure pour eux d’aller à l’école. Au revoir.
Elle se tournait pour suivre ses enfants quand je saisis ses poignets.
— Fiona, vous…
Mais les mots qui se pressaient furent refoulés sans ménagement par l’éclat terrifiant de ses yeux, semblable à celui qui les animait lorsque je l’avais découverte aux prises avec Nasser. Je lâchai ses poignets ; ses yeux se calmèrent.
— Excusez-moi. Il ne faut pas.
Je la laissai partir. En me retournant, j’aperçus au loin Hermann Kopf qui nous observait.
Le soir, après un repas qui me fut une souffrance, Kopf, contrairement à l’habitude qui voulait que nous nous séparions et retournions chacun dans nos appartements, me convia à prendre un cognac. Il m’entraîna dans une pièce basse où je n’avais jamais pénétré. Dans la cheminée, une flambée nous accueillit d’un chaleureux crépitement. Un moment, j’oubliai mon tourment et m’étonnai à haute voix de ce lieu qui m’était inconnu, si différent de ceux que je connaissais ; on avait en effet l’impression de se retrouver dans un chalet de montagne.
— Vous manquez d’imagination, mon cher. Vous ne connaissez presque rien de cette pyramide, et je tiens à ce que vous restiez dans cette ignorance ; mais de grâce, imaginez-la, recréez-la à votre guise !
Nous nous installâmes après que Kopf nous eut servi une généreuse dose d’alcool. Nous nous tenions tous deux face aux flammes, évitant de nous regarder.
— Vous souffrez, mon cher. Ne le niez pas. Et vous allez souffrir plus encore si vous vous obstinez. J’ai bien observé cette jeune femme ; elle n’est pas pour vous. Ni pour vous, ni pour personne, comme je vous l’ai déjà dit, hormis ses enfants et un rêve étrange, impénétrable. Non, inutile de me poser à nouveau la question : elle ne m’a pas parlé. Pas avec des mots, en tout cas. Mais ses gestes, son attitude me parlent, à son insu. Je vous suis reconnaissant de l’avoir amenée. Ses yeux s’ouvrent sur une perspective de la mort qui… qui me bouleverse.
Pour la première fois, je perçus une émotion dans le timbre de la voix de Kopf, et j’en ressentis une vive brûlure.
— Moi qui suis tant préoccupé par ce vrai versant de la vie, comme vous le savez… J’avais déjà beaucoup imaginé, tissé bien des rêves sur cette attente… mais elle… Devant elle, je me sens comme un moinillon débile face à un grand prêtre… Elle sait… Elle sait !
Je fus pris de terreur et de fureur.
— Vous êtes fou ! Qu’allez-vous imaginer ? Fiona a souffert, mais rien ne vous…
Kopf s’était tourné d’un bloc vers moi et je me tus aussitôt. Je crus qu’il allait se jeter sur moi, m’étrangler. Cela dura de longues secondes, puis il retrouva en un mouvement son calme glacial et impénétrable.
— Je vous laisse. J’ai du travail. Vous passerez dans mon bureau demain matin, j’ai une nouvelle mission à vous confier.
Kopf est fou… fou à lier. Toute la nuit, je remuai cette pensée en tous sens, cherchant en vain une solution – mais à quoi ? Pour qui ?
Au matin, je me rendis comme un automate dans le bureau de Kopf. Il était assis devant une feuille de papier qu’il emplissait de son écriture régulière, méthodique, propre et pourtant indéchiffrable pour qui n’y était pas initié. Il jeta un œil négligent sur moi, mais ne dit rien et me fit signe de m’asseoir à ma place habituelle.
— Je souhaite que vous retourniez au Caire. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de revoir Nasser. Depuis mes démêlés avec la justice, les choses se sont tassées et j’ai noué de nouveaux contacts. Je souhaite acquérir une momie, et une opportunité se présente. Je ne puis toutefois me rendre en Égypte, où je suis fiché, et il faut absolument que quelqu’un y rencontre la personne qui peut m’aider. Vous irez donc à ma place. Vous verrez, c’est plus difficile de faire quitter l’Égypte à une momie qu’à sept vivants, et qui sait qu’un peuple entier, mais c’est aussi passionnant. Votre avion part ce soir.
Il me tendit une enveloppe contenant un billet d’avion et de l’argent, et me congédia d’une phrase :
— Bon voyage, mon cher, et ramenez-moi de quoi m’étonner davantage.
Une fois de plus, je ne protestai pas ; pourquoi l’aurais-je fait ? Je montai préparer mes bagages. Puis, je résolus de transgresser l’ordre implicite et je franchis plusieurs portes inconnues, à la recherche de Fiona. Je découvris des pièces de toutes sortes et crus m’être perdu lorsque je tombai sur Kopf.
— Vous vous égarez, mon cher. Venez, je vous raccompagne. Je vous conduis moi-même à l’aéroport. En route, il est temps.
*
J’y ai cru, à cette quête de momie… Le contact, au Caire, est venu me rencontrer. La première discussion fut presque anodine. Il est revenu cinq jours plus tard, durant lesquels j’ai traîné dans les rues de la ville. Il m’a prévenu que nous devions partir pour un long périple à l’intérieur du pays, et que ce serait moins confortable que mon palace.
J’ai téléphoné chez nous, avec l’espoir insensé que ce soit Fiona qui décroche. Kopf m’a laconiquement souhaité bon voyage. Sa voix était froide, mais pas plus que de coutume ; je n’ai pas osé prendre de nouvelles de Fiona, me contentant d’un « tout va bien ? » qu’il n’a pas exploité. Et je suis parti pour cette exploration, le cœur serré, mais sans appréhension particulière.
Ce fut pénible, comme on me l’avait annoncé, et vain. Nous passions notre temps en palabres interminables auxquelles je ne comprenais que ce que l’on daignait me traduire, et que je devinais être peu de chose par rapport à ce qui se disait en arabe. Nous ne vîmes pas la moindre momie, sinon quelques mauvais clichés qui auraient pu être pris dans n’importe quel musée du monde. Il fallait soi-disant convaincre des intermédiaires tous indispensables et tous récalcitrants. Le meilleur argument restait l’argent, en Égypte comme chez nous ; je rechignais, négociais et ne payais qu’une partie, sachant que c’était déjà trop.
Nous revînmes au Caire bredouilles, du moins à mes yeux, car mon contact, qui s’était révélé être un compagnon de route presque agréable, m’assurait que cela évoluait de façon très favorable.
Le concierge me remit la lettre de Kopf à mon arrivée.
« Mon cher,
« Vous allez sûrement m’en vouloir, car malgré les grandes qualités que j’ai pu apprécier en vous au cours de ces quelques mois vécus en votre agréable compagnie, je ne pense pas être arrivé à vous faire comprendre ni même entrevoir la réelle approche que j’opère de la vie et de la mort. Je ne sais comment vous interprétez mon goût pour les momies, ni si vous appréciez à sa juste mesure la pyramide que nous avons érigée ensemble. Mais cela n’a pas d’importance, ou du moins cela n’en a plus ; je ne puis qu’espérer que vous évoluerez et que vous finirez par me comprendre.
« Cela dit, j’en doute, et pour ces mêmes raisons qui m’ont amené à vous éloigner d’ici et à ne pas vous impliquer dans l’achèvement de ma quête. Sachez-le de suite : vous reviendrez ici sans momie, qui n’était qu’un prétexte pour vous éloigner, mais vous ne me reverrez plus, ni Fiona que vous aimez et ses enfants ; et ce parce que vous l’aimez et n’étiez pas digne de passer l’éternité en sa compagnie.
« Mais laissez-moi tout d’abord, bien que je devine que votre état présent, après cette brutale révélation, ne vous prédispose pas à une lecture sereine (mais vous relirez, vous êtes méticuleux), laissez-moi vous expliquer par le menu un plan dont vous auriez dû être acteur jusqu’au dénouement.
« Je n’entreprendrai pas de vous faire pénétrer dans mon regard ; l’étroitesse de la vie vous paraît déjà trop vaste, et ma vision de la mort n’a rien à voir avec ce que la religion qui pourrait être la vôtre vous propose comme consolation. Vous auriez pu néanmoins imaginer – et peut-être est-ce le cas, mais j’en doute – que ma passion des momies ne se cantonnerait pas dans le goût des collections. Je n’ai vécu longtemps, comme on pourrait le croire un peu hâtivement, dans l’attente de la mort libératrice ; la mort ne me libérera pas, puisque la vie ne m’a pas emprisonné. Pour tout dire, la frontière n’existe pas à mes yeux et je n’ai pas eu trop de ces années pour préparer la véritable éternité, que recherchaient avec rage et désespoir mes chères momies. Éternité de l’âme qui ne serait que fumisterie sans celle du corps ; il me fallait des années, n’est-ce pas, pour trouver la solution et rassembler les moyens financiers nécessaires. Vous y avez contribué pour une part essentielle.
« Une chose me tracassait cependant : combien accédaient à cette double pérennité ? Mourir, oui ; mais se retrouver seul… Je vous devine qui pensez : Hermann Kopf est fou. Si cela peut vous aider, pensez-le. Vous pouvez croire aussi que je suis génial, et ma modestie y consentira. Cela n’a pas la moindre importance ; ce qui compte, c’est que j’ai réussi au-delà de mes espérances.
« Vous ignorez presque tout de la pyramide, et celui qui aurait pu vous éclairer ne le pourra plus : comme vous le prouvera la coupure de presse que je joins à cette lettre, le malheureux Fritz est mort dans un stupide accident de montagne. Vous comprendrez que je ne pouvais prendre aucun risque… Cela dit, Fritz ignorait lui-même bien des aspects ; je lui ai fait intégrer dans la construction des éléments dont il ne sut jamais la fonction que je leur destinais ; et tout n’est-il pas une question de point de vue ? Un système de verrouillage et de blindage ne sert-il pas à interdire l’accès aux voleurs ? Certes, mais aussi à empêcher toute sortie pour les occupants.
« Je suis cruel envers vous ; venons-en au fait. Avec le visiteur arrivé la veille de votre premier voyage en Égypte, j’ai pris quelques précautions et apporté quelques modifications à la pyramide. Ainsi, au cas où je mourrais inopinément, un capteur relié à mon cœur condamnerait automatiquement tout accès à la pyramide (ainsi que toute sortie) et mettrait sous tension, dans la propriété, un champ de mines infranchissable, même pour une armée de professionnels ; à l’intérieur, un ingénieux système d’assèchement de l’air se mettrait en route, selon un procédé qu’il serait trop long de développer. Nous corps se seraient retrouvés asséchés en quelques heures sans devoir subir les métamorphoses des antiques momies, et nous aurions conservé le meilleur aspect qui soit dans une pyramide complètement retranchée du monde et de l’air extérieur. Inutile d’essayer y pénétrer.
« Mais je ne devrai pas recourir à ce système et je pourrai réaliser mieux : quelque part dans ce bâtiment, il y a un réseau de pièces que je mets quiconque au défi de trouver ; cet « appartement » se retrouvera d’ailleurs protégé de toute effraction, et la vengeance du Pharaon Kopf fera périr celui qui tenterait d’en transgresser le seuil ! Car la technique moderne m’a offert des moyens autrement plus efficaces que ceux dont disposaient mes lointains ancêtres…
« C’est de cet endroit que je vous écris. J’ai fait venir Fiona et ses enfants ; ceux-ci jouent dans ce que je leur ai présenté comme une chambre de jeux, et il se peut qu’il en sera ainsi. Fiona est assise, silencieuse, face à moi. Elle attend que je lui révèle enfin ce que je veux d’elle, mais son extraordinaire regard me dit qu’elle a compris, et qu’elle est prête. À quoi bon, toutefois, vous l’écrire : vous ne me croirez pas, ou n’en serez que plus malheureux.
« Quand j’aurai achevé cette tâche, j’enclencherai un système analogue à celui que je vous ai décrit pour la pyramide, mais qui n’agira que dans cet appartement secret. Je ne sais pas encore si, avant l’arrivée du gaz, j’aurai l’audace de prendre Fiona dans les bras.
« Personne ne doit se douter de rien ; le même ami qui s’est occupé de Fritz et des transformations a tout orchestré : officiellement, nous sommes tous les quatre partis ce matin pour une croisière en Méditerranée, et lorsque vous découvrirez cette lettre, on apprendra notre naufrage. Vous ne pouvez plus nous « sauver » et j’ai fait de vous mon légataire universel ; j’ose espérer que vous aurez la sagesse de ne rien dévoiler. Vous y perdriez tout, jusqu’à la vie, et vous n’êtes pas à même de savourer la mort comme il se doit. Je vous prierai donc, une fois que vous aurez lu cette lettre et que vous aurez confirmation de notre naufrage, de revenir aussitôt vous installer dans la pyramide ; vous serez le gardien de notre éternité, pour quelques années du moins. Vous aurez ainsi le loisir d’imaginer le meilleur système pour après ; j’ai d’ailleurs laissé quelques notes sur votre bureau qui vous seront précieuses, car votre imagination m’a toujours un peu déçu.
« Vous devinez que vous auriez pu, vous aussi, être de ma suite… C’est à Fiona que vous devez ce salut, ou cette damnation – vous connaissant, je pencherai plutôt pour la seconde solution. Vous pouviez être si romantique, lorsque je vous ai surpris au bord de l’étang !
« Laissez-moi vous dire que cette jeune femme fut pour moi aussi un éblouissement. Je vous répète qu’elle ne m’a rien dit, rien révélé ; mais je suis convaincu, rien qu’à son regard, que sa connaissance de la mort est prodigieuse. J’attends avec impatience que nous puissions en parler – dans la mort, puisque je sais qu’elle ne me dira rien avant. Je lui permets d’emporter ses enfants et je la dispense de la présence d’un amoureux languissant qui lui ferait sembler longue l’éternité. J’imagine déjà ces lieux retentir des rires enfin sans retenue de ses enfants, Fiona et moi devisant dans le calme des nombreuses pièces douillettes que je nous ai réservées.
« Vous comprenez pourquoi votre présence aurait été une gêne pour nous.
« Sans doute me comparerez-vous à un de ces gourous qui entraînent dans leur folie suicidaire une foule d’adeptes drogués. Ne soyez pas idiot : je n’ai pas d’adeptes, et je respecte trop le corps, j’ai trop besoin de lui pour le livrer à des mains étrangères. Et celui de Fiona doit être trop parfait pour que quiconque puisse le dévoiler.
« Je devine que ces paroles vous font souffrir. Allons, ressaisissez-vous, mon cher. Si vous savez rester discret, ma fortune vous appartient. Je compte sur vous pour prévenir toute intrusion dans notre domaine. Je vous répète qu’il est trop tard pour nous sauver à l’heure où vous lirez ces mots. Bien que cela soit théoriquement impossible, vous aurez peut-être la tentation de chercher à enclencher le système touchant toute la pyramide, dans le fol espoir de nous rejoindre ; je ne crois pas que votre improbable éternité croisera jamais la nôtre, et nous prendrons, Fiona et moi, toutes les mesures en ce sens.
« Consolez-vous en pensant ce que vous voulez de moi. Et si je vous affirme que ma reconnaissance éternelle vous est acquise, vous devinez que sous ma plume ce n’est pas un vain mot. Vous conservez malgré tout votre part de rêve, et je ne pense pas que Fiona vous aurait jamais accordé davantage ; de surcroît, vous restez notre voisin, en quelque sorte. Prenez soin des autres domestiques, gérez tout cela à votre guise, je vous fais confiance.
« Je ne sais quel mot utiliser pour prendre congé de vous, mon cher. Au revoir : je n’y compte pas ; adieu : je n’y crois pas.
« De notre éternité, nous vous saluons, Fiona et moi. J’allais oublier les enfants. »
*
À quoi bon dire que Kopf est un assassin ? Je suis revenu ici, dans la pyramide. Tout s’est déroulé comme il l’a prévu. Je n’ai pas encore cherché à découvrir l’accès à leur « appartement » et je ne crois pas que je le ferai jamais. À cause de ma folle et dérisoire passion, trois innocents sont morts ; à quoi puis-je encore prétendre ? Tenter de les rejoindre ? Idiotie ; pourquoi la mort réunirait-elle ceux que la mort a séparés ? Partir à la recherche de Maramisa ? Chimère, sans doute ; Fiona j’en a jamais parlé, et dois-je me fier à Nasser ? Alors ? Faire des phrases et regarder le soleil se coucher. Songer à ce qu’il adviendra de la pyramide et de son secret après moi. Dans longtemps, sans doute, car je vais rester ; et la médiocrité conserve. Des phrases, et le soleil qui se lève. Boire l’écrasante sagesse de la vie jusqu’à la lie.